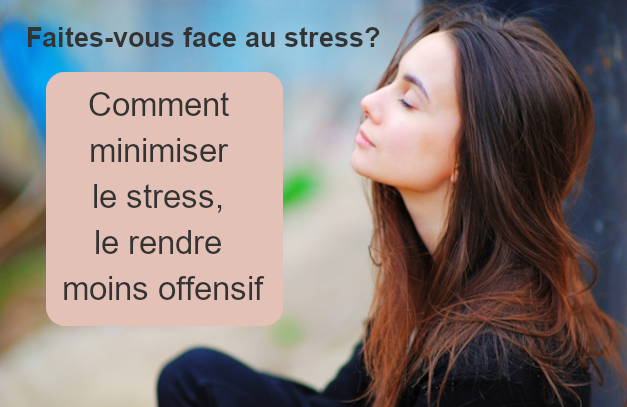Objet
En psychanalyse, la notion d'objet revêt un sens précis : c'est ce vers quoi tend la pulsion. Ce peut être un objet au sens ordinaire ou une personne ou son propre corps.
Définition de Ghylaine Manet

« L'objet (Objekt) de la pulsion est ce en quoi ou par quoi la pulsion peut atteindre son but. Il est ce qu'il y a de plus variable en la pulsion, ne lui est pas originairement lié, mais ne lui est adjoint que par suite de son aptitude à rendre possible la satisfaction. »(1) L'objet est l'un des quatre éléments constitutifs de la pulsion sexuelle (poussée, but, objet, source). Sa variabilité est alimentée par la capacité de la pulsion à s'étayer sur les soins maternels et sur la plupart des fonctions organiques, ce dont témoignent les organisations sexuelles infantiles (orale, sadique-anale, phallique). Les équivalences symboliques inconscientes, comme sein = fèces = argent = cadeau = enfant = pénis(2), participent de la variabilité de l'objet.
En 1905, Freud démontre que la sexualité humaine est indépendante de la procréation(3) ; la pulsion sexuelle apparaît dès la naissance, et ses objets, dépendant du développement et de l'histoire infantiles, se substituent les uns aux autres. Du pouce sucé (objet partiel) à l'amant embrassé (choix d'objet), en passant par la peluche (objet transitionnel) et les figures parentales que la petite enfance a fomentées (objet du fantasme), jusqu'à l'amour de soi-même ou de qui nous ressemble (choix d'objet narcissique) ainsi qu'aux chaussures, fourrures, etc. (fétichisme), l'objet se déplace. Selon Freud, comme selon l'histoire de la langue, l'objectivité procède d'un travail de séparation et de désinvestissement relatifs aux objets de la pulsion sexuelle.
Si Freud a insisté sur le primat de la dynamique pulsionnelle, dont l'objet n'est qu'un corrélat, ses successeurs sont revenus à la « relation d'objet ». Lacan ontologise la notion freudienne d'objet partiel, labile et contingent. L'objet est ce dont le désir est toujours en quête. Mais l'objet est toujours déjà perdu, cause – et non objet – de la quête du désir, qui n'est donc que métonymie.
En 1905, Freud démontre que la sexualité humaine est indépendante de la procréation(3) ; la pulsion sexuelle apparaît dès la naissance, et ses objets, dépendant du développement et de l'histoire infantiles, se substituent les uns aux autres. Du pouce sucé (objet partiel) à l'amant embrassé (choix d'objet), en passant par la peluche (objet transitionnel) et les figures parentales que la petite enfance a fomentées (objet du fantasme), jusqu'à l'amour de soi-même ou de qui nous ressemble (choix d'objet narcissique) ainsi qu'aux chaussures, fourrures, etc. (fétichisme), l'objet se déplace. Selon Freud, comme selon l'histoire de la langue, l'objectivité procède d'un travail de séparation et de désinvestissement relatifs aux objets de la pulsion sexuelle.
Si Freud a insisté sur le primat de la dynamique pulsionnelle, dont l'objet n'est qu'un corrélat, ses successeurs sont revenus à la « relation d'objet ». Lacan ontologise la notion freudienne d'objet partiel, labile et contingent. L'objet est ce dont le désir est toujours en quête. Mais l'objet est toujours déjà perdu, cause – et non objet – de la quête du désir, qui n'est donc que métonymie.
Définition de Larousse
[source Larousse]
[source Larousse]

En psychanalyse, l'objet est un concept polysémique. Il est ainsi question d'objet partiel, d' objet total, d'objet narcissique, interne, externe, de choix d'objet, de relation d'objet, etc. En premier lieu chez Freud, l'objet est celui de la pulsion. Visé comme totalité (en tant que personne, entité, idéal...), ce peut être un objet d'amour (ou de haine). Plusieurs autres théories ont été élaborées à partir de la notion d'objet en psychanalyse, notamment par Melanie Klein et les kleiniens. L' « objet transitionnel » est une notion de Donald Winnicott, l'« objet a » un apport théorique de Jacques Lacan.
Définition de Wikipédia
[Source Wikipédia]
[Source Wikipédia]
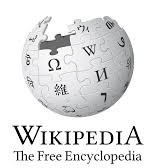
Objet dans les articles